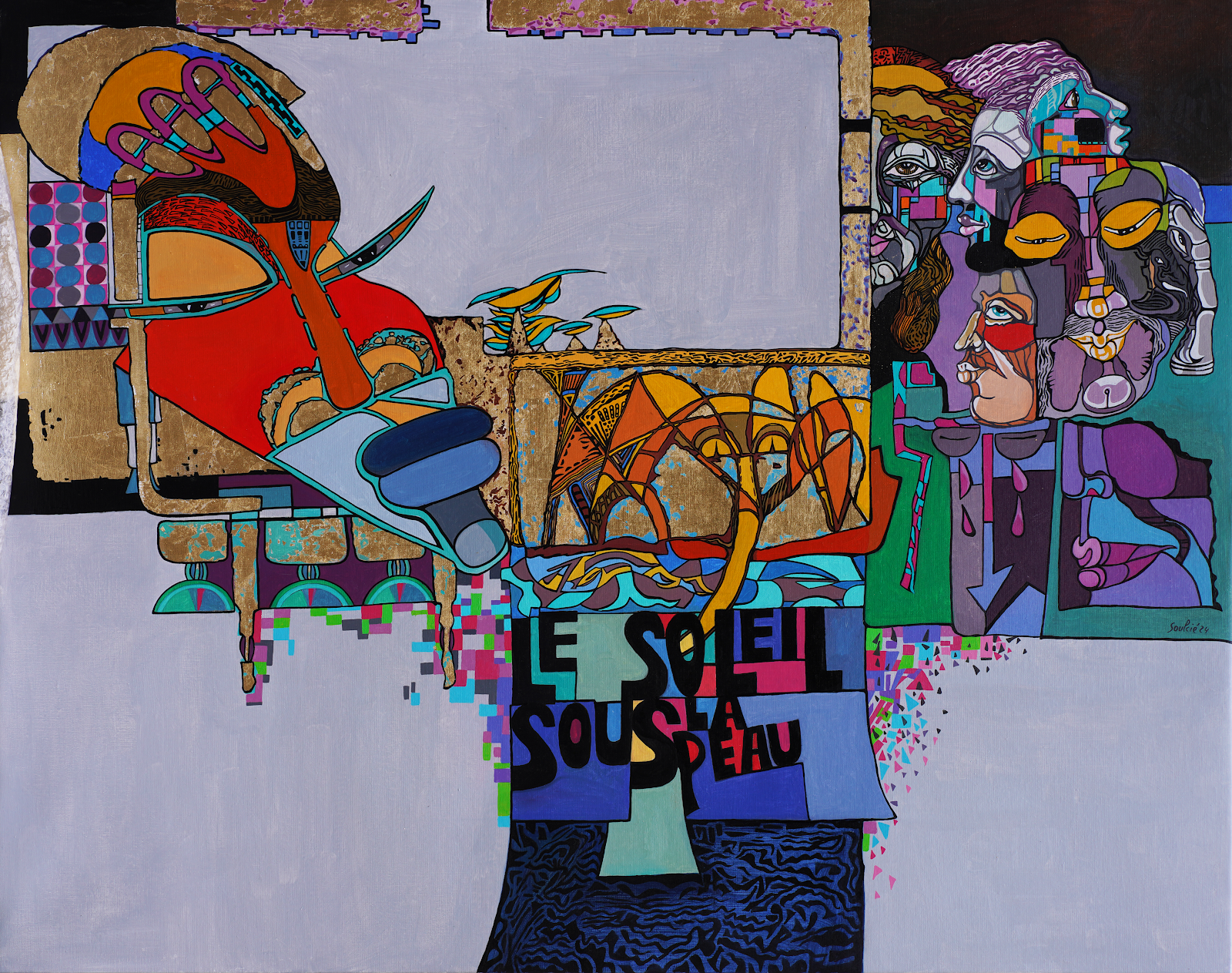Exposition
Béatrice Helg
Géométries
du silence
Dans
le cadre d’Arles associé des Rencontres d’Arles 2025
Musée
Réattu, Arles
Du 5
juillet au 5 octobre 2025

Béatrice Helg, Cosmos XVIII (2018), chapelle du musée Réattu, 2025
L’étrange opalescence
des mondes révélés
Cette exposition monographique présente plus
de 70 photographies réalisées au cours des 35 dernières années par Béatrice
Helg, grande photographe suisse, née à Genève. Cette dernière pratique une
approche où la rigueur de la construction formelle ouvre sur un univers qualifiable
de magique et/ou de mystique.
Commençons à l’envers de la monstration pour
démarrer avec un premier éblouissement dans la Chapelle où se trouve Cosmos
XVIII (2018), une oeuvre monumentale comprenant le fameux disque qui
irradie. Une double possibilité de vue se trouve possible, celle du haut où la
photographie apparaît comme par magie, ou celle du piéton qui entre dans la
chapelle et se trouve confronté à un autre agencement. Dans les deux cas,
demeure un choc visuel qui déclenche une émotion puissante. Certaines de ses
œuvres se trouvent parmi les collections du musée, comme des Esprit froissé
(1999-2001) qui dialoguent avec les fascinantes Grisailles du Temple de la
Raison de Jacques Réattu, commandées par les Montagnards durant la
Révolution française. Le rapport idéologique très étrange entretenu entre le
culte de la Raison et les esprits (lesquels ? ) ouvre sur un
questionnement, à la fois esthétique, politique et métaphysique.

Béatrice Helg, oeuvres, vue partielle, musée Réattu, 2025
Béatrice Helg
crée des espaces avec des matériaux de construction, du métal rouillé,
des feuilles de verre, des plaques d’isolant, des papiers, etc. et de la
lumière. La prise de vue permet alors de mixer l’ensemble, oserait-on dire, de
le transcender, pour d’obtenir quelque chose de radicalement différent, de
l’art. Le tout repose sur une perception patiente en attendant de trouver le
moment « juste » de la prise de vue, l’instant où tout prend forme dans
une unité retrouvée. La créatrice dit : « La photographie est
une écriture de lumière — de l’obscur et de la lumière dans l’espace. Elle me
permet d’explorer l’invisible l’insoupçonné, l’espace du dedans. C’est une
autre manière d’appréhender, de questionner le réel, la vie, le monde. » De
nombreuses séries prennent place dans les étages du musée. Dans Émergence,
surgit une masse centrale, verticale, ressemblant à quelque monolithe immatériel,
tandis que dans Crépuscule celle-ci est horizontale. Avec ces
deux possibilités, la perception de l’œuvre s’en trouve totalement changée. Si
la science-fiction et ses visions demeurent en embuscade, l’artiste a véritablement
œuvré avec l’astrophysicien français Jean-Pierre Luminet. Des œuvres des débuts
comme Théâtres de la lumière et Scala mettent en avant le monde
de la musique (elle a étudié le violoncelle) et de l’opéra, ce qui nous
conduirait à placer l’ensemble sous la théorie de l’harmonie des sphères de
l’Antiquité.
Christian Skimao